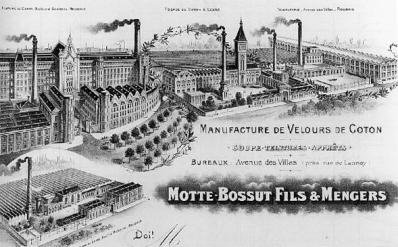Nord
Nord en vert pastel
Le Nord est le département français comprenant les territoires les plus septentrionaux de la France. Avec 2 595 536 habitants en 2013, il est le département le plus peuplé du pays, porté par la métropole lilloise qui abrite presque la moitié de sa population. L'Insee et la Poste lui attribuent le code 59. Formant auparavant, avec le Pas-de-Calais, l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais, il constitue depuis 2016, avec quatre autres départements, la région Hauts-de-France.
Il est constitué de la Flandre française, qui correspond aux arrondissements départementaux de Dunkerque, de Lille et de Douai (autrefois partie du comté de Flandre), du Cambrésis (autour de Cambrai, ancienne principauté ecclésiastique), de l'Avesnois (autour de Maubeuge) et de la partie méridionale de l'ancien comté de Hainaut (autour de Valenciennes). En fait, le département du Nord décrit un tracé similaire à la Province de Flandre pré-révolutionnaire, qui avait adopté le blason au lion noir de l'ancien comté de Flandre même si cette province incluait aussi le Cambrésis, l'Avesnois et une partie du Hainaut en plus du comté de Flandre proprement dit.
C'est aussi un département avec une population jeune, abritant plusieurs universités dont le pôle universitaire de Lille qui est le 3e de France.
La Langue:
Le picard chti (appelé rouchi à Valenciennes) : Avesnois, Cambrésis, Flandre romane (arrondissements de Lille et de Douai) et Hainaut français (Valenciennois).
Le flamand : Flandre maritime, de la rivière Lys à la Mer du Nord, c'est-à-dire de Bailleul à Dunkerque. Dans cette ville, le flamand est également appelé dunkerquois, car il présente des spécificités.
Le territoire comprenant les actuels arrondissements de Lille, de Douai et de Dunkerque fut progressivement incorporé au Royaume de France sous le règne de Louis XIV. La région ne devint définitivement française qu'après 1713, avec le traité de la paix d'Utrecht.
Les habitants du Nord sont le plus souvent appelés Nordistes. La construction de ce gentilé est pourtant impropre : il faudrait plutôt les appeler Nordiques, puisque le suffixe -iste indique généralement l'adhésion à une cause. On a par exemple appelé "nordistes" les partisans du Nord dans la guerre de Sécession.
Le canal du Nord est un canal de jonction reliant la vallée de l'Oise au canal Dunkerque-Escaut. Il possède deux biefs de partage alimentés par pompage depuis l'Oise et l'Aisne, et reçoit également les excédents de la Somme à hauteur d’Épénancourt. Imaginé vingt ans après le plan Freycinet pour promouvoir un gabarit de navigation supérieur au canal de Saint-Quentin, sa construction, amorcée en 1913, a été interrompue par les deux guerres mondiales et les difficultés économiques de l'entre-deux-guerres. Il a été finalement ouvert à la navigation en 1965.